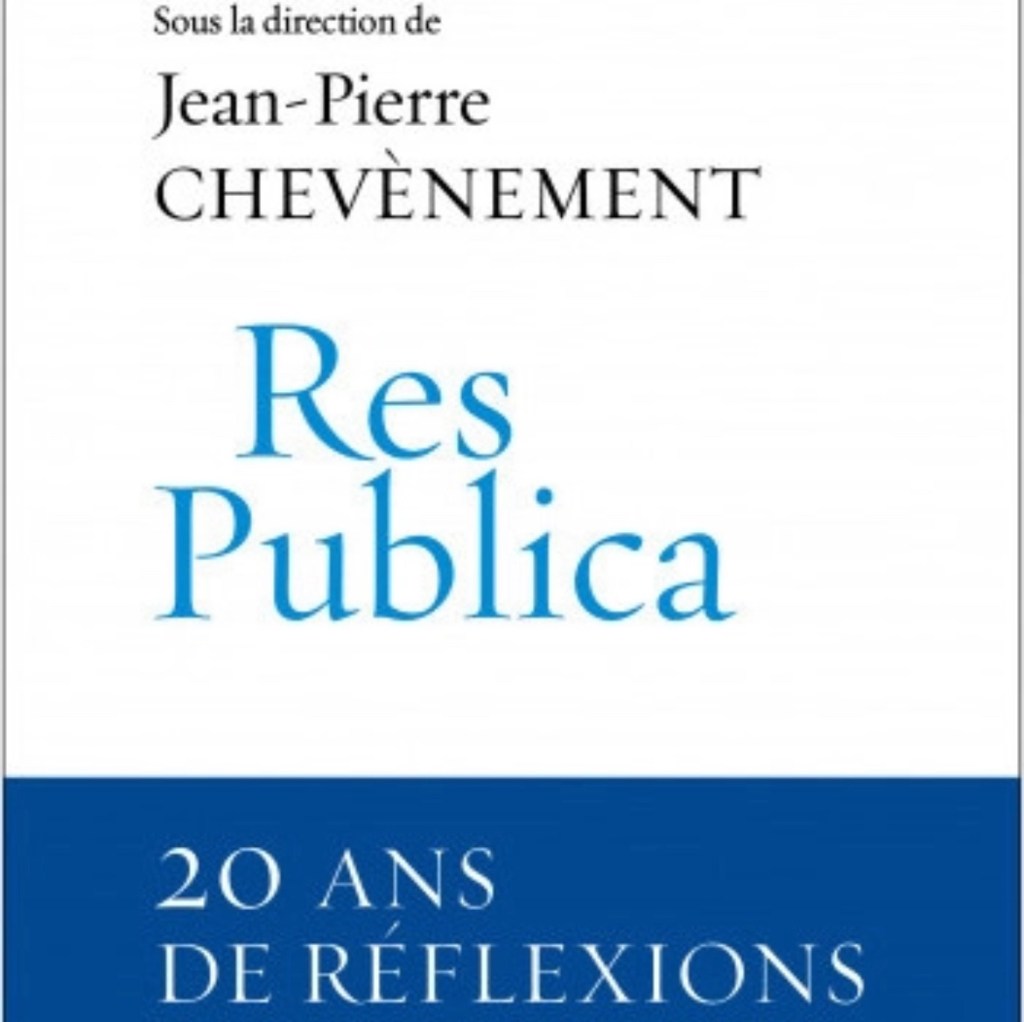
ARTICLE – Europe, école, laïcité, réindustrialisation :
la Fondation Res Publica rassemble « 20 ans de réflexions pour l’avenir »
Bonnes feuilles
Par Etienne Campion Publié le 06/11/2024
À l’occasion de son vingtième anniversaire, la Fondation Res Publica publie un manifeste aux éditions Plon, visant à fournir des « munitions pour l’avenir » sur des sujets comme la souveraineté, l’intégration, et la réindustrialisation. « Marianne » publie en exclusivité des extraits de ce livre qui compile « vingt ans de réflexions pour l’avenir ».
Depuis sa création en 2004 par Jean-Pierre Chevènement, grâce à ses iconiques cahiers bleus, la Fondation Res Publica s’est imposée comme un espace de réflexion et de propositions sur les enjeux majeurs du débat public : nation, souveraineté, énergie, école, laïcité… À l’occasion de son vingtième anniversaire, les membres de la fondation font paraître chez Plon un recueil de réflexions, un manifeste, des « munitions pour l’avenir », Marianne en publie des extraits exclusifs.
À LIRE AUSSI : Chevènement : « J’ai pensé, peut-être naïvement, que le président se conformerait aux intérêts supérieurs de la France »
Ces réflexions explorent des questions essentielles pour l’avenir de la France : le rôle de l’Europe et la préservation de la souveraineté nationale, la crise de l’intégration, l’état de notre école et la nécessaire réindustrialisation. À travers les contributions de figures telles que Marie-Françoise Bechtel, Souâd Ayada, Joachim Le Floch-Imad, et Louis Gallois.
Marie-Françoise Bechtel : « La France et l’Europe, ou l’avenir de la question nationale »
Trois décennies après Maastricht et l’ouverture au grand large de la mondialisation avec l’Acte unique, quinze ans après le traité de Lisbonne, sans oublier le Brexit, quel est au fond le bilan ? Le PIB des pays de la zone euro qui était encore, à sa création, égal à celui des États-Unis, n’en représente aujourd’hui que moins des deux tiers, après plus de vingt ans de monnaie unique. Celle-ci s’est imposée au prix d’une marche forcée des économies derrière le modèle allemand : la crise grecque, la dévitalisation de l’industrie française, et aujourd’hui de la compétitivité de son agriculture en sont, entre autres, les témoignages.
On n’aura garde d’oublier les ravages causés en parallèle par la concurrence interne au sein d’une Union élargie à douze puis quinze puis vingt-sept, l’affaiblissement des services publics, la concurrence des travailleurs. Il faut y ajouter la confiscation de pans entiers de la souveraineté nationale par les institutions de Bruxelles. Et on ne saurait oublier le passage à la toise globishdes langues et cultures. Tout cela a pesé lourd dans le verdict du peuple français consulté en 2005 sur le projet de Constitution européenne. Face à ce bilan, une certaine solidarité européenne dans la gestion de la crise économique déclenchée par le Covid, perspective qui reste incertaine pour les défis futurs, doit être mise en balance avec le fait qu’aucun instrument commun ne soit véritablement prévu pour faire face à la concurrence de la loi américaine de réduction de l’inflation (IRA), au renchérissement du coût de l’énergie, aux insuffisances des investissements dans la recherche et la technologie qui sont les questions cruciales d’un avenir européen.[…]
Un dialogue de sourds s’est instauré entre défenseurs psittacistes de « l’Europe qui protège » et partisans fiévreux d’une sorte de défi mal soupesé, jeté au nom de la souveraineté bafouée. Que faire ? Il faut ouvrir des perspectives, penser le futur à partir de la question nationale et non contre elle, rejetant la logique identitaire figée au profit d’une idée confédérale où les talents de nos nations seraient développés et non rabotés. […] À un élargissement qui mettrait en péril la paix et la sécurité du continent européen, il faut plus que jamais opposer le modèle confédéral joint à une architecture de sécurité pour l’ensemble du continent.
Souâd Ayada : « L’école, la France et la nation »
Notre école est aujourd’hui défaite, livrée à ce qui, de l’intérieur, la décompose, et exposée à ce qui, de l’extérieur, veut la détruire. La vision de l’homme sur laquelle elle s’est historiquement appuyée semble épuisée. […] Certes, on y accueille des enfants de plus en plus tôt et on y occupe des jeunes gens qu’on veut garder dans le giron scolaire le plus longtemps possible. Mais pour quoi faire exactement ? Dans quel but qui relèverait des pouvoirs et des devoirs de l’école, et qui ne serait pas encore une façon de colmater les brèches que les maux de la société ont ouvertes partout en elle ?
L’école française est le théâtre de tous les renoncements. Pour l’adapter à un corps social que l’on a laissé s’enfoncer dans l’individualisme et le communautarisme, et pour tenter d’apaiser les conflits d’un type nouveau qu’il engendre, on a frappé de nullité les idéaux régulateurs qui la guident. L’école n’est plus seulement défaite, elle est aussi l’école de la défaite. Désarmée, elle n’est pas sans faire écho à L’Étrange défaitedont témoignait Marc Bloch en 1940. La même impuissance, faite de bureaucratie et de dilution de la responsabilité, dessine un fil transhistorique où se forme le malheur français. C’est l’amertume de la défaite que nous devons avaler quand un proviseur est poussé à la démission pour avoir voulu appliquer la loi dans son établissement.
On aura beau user de tous les trucages rhétoriques, nul n’est dupe de ce qui a réellement lieu : une défaite et la déposition d’un vaincu. C’était le venin de la défaite qui, le 13 octobre 2023, jour de l’assassinat de Dominique Bernard, reprenait le pouvoir sur nous, révélant la victoire de l’ignorance et de la laideur sur ce qui s’offrait comme son meilleur antidote, la vérité et la beauté de la littérature. C’était le poison de la défaite qui, le 16 octobre 2020, jour de l’égorgement de Samuel Paty, se diffusait dans la moindre parcelle de l’école. Comme si la mise à mort d’un professeur ne suffisait pas, il a fallu s’accuser de tenir à une liberté d’expression qui pourtant passait jusque-là pour la condition de l’enseignement. Certains ont même trouvé des raisons à ceux qui exècrent la conception de la liberté qui soutient notre école. Étrange chose que le génie français de notre temps, qui veut que l’on devienne l’ennemi de soi-même faute de distinguer le véritable ennemi et de le combattre.
La décapitation du professeur d’histoire-géographie, non loin du collège où il enseignait, a révélé au grand jour l’ampleur de la défaite. A-t-on saisi la nature véritable de ce qui se dévoilait à nous et qui porte bien au-delà de l’école ? Nous n’avions pas tort de rappeler la contestation continue, ici et là, depuis des années, des valeurs de la République et de la laïcité. Mais était-ce là atteindre l’essentiel, c’est-à-dire ce qui permet de comprendre un effondrement entraînant avec lui tout ce qui constitue l’école comme telle ?
Qu’on la conçoive comme une plaque sensible ou comme un miroir grossissant, elle témoigne de l’état du corps social. Notre école manifeste tous les symptômes d’un corps social malade auquel la politique rechigne à s’appliquer, faute de clarté dans la pensée, de fermeté de la volonté et de cap clairement défini. Elle prend de plein fouet la faillite de l’autorité de l’État ; elle ne se remet pas de la fin de la politique que s’est résolu à désirer un peuple comblé par les jouissances démocratiques, et dont le programme a été achevé par une manière de faire de la politique, toute technocratique et gestionnaire.
Joachim Le Floch-Imad : « La crise de l’intégration, un défi pour notre nation, un défi pour notre jeunesse »
Répondre à la « crise de l’intégration » implique d’abord de reconnaître qu’un seuil de tolérance a été franchi et qu’aucune politique d’intégration digne de ce nom n’est possible à flux migratoires constants. […] La France doit décider souverainement de qui entre sur son sol et proportionner l’accueil à la capacité d’intégration. Cela passera par une atténuation des différentes incitations à l’immigration, une évolution des conditions d’octroi de l’asile, du regroupement familial et de la nationalité et, bien sûr, une révision constitutionnelle. Ce dernier point est central tant il importe de redonner le pouvoir au Parlement, émanation de la volonté générale, face à des juridictions européennes et à leurs relais nationaux zélés dont les décisions ont pris le pas sur les choix politiques démocratiques.
Puisqu’il incombe d’offrir à notre jeunesse dans son ensemble l’accès à un héritage partagé venu du fond des âges, il nous faut revitaliser les principes cardinaux sans lesquels ce processus ne peut être que chimérique. Vingt ans après la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école, huit Français sur dix estiment que la laïcité est menacée. Le reste du monde, en particulier les organisations internationales, ne comprend pas la singularité de notre approche et s’emploie à la détricoter.
Surtout, les périls se multiplient sur notre sol : résurgence des obscurantismes et des entrepreneurs de haine ; progression d’une conception légalitaire de l’islam ; déconstructionnisme et mutations de la gauche, passée de l’universalisme à la défense du « droit de ne pas être offensé ». Une fois les leçons des guerres de religion tirées, la République s’est faite sur l’idée d’une nécessaire réserve dans l’expression publique des religions, d’un « pacte de discrétion » (Jean-Éric Schoettl) impossible à imaginer chez nos voisins. Les Anglais, par exemple, trouvent naturel que la gare de King’s Cross affiche, pendant le ramadan, un « hadith du jour ». Nous ne voulons pas d’un tel modèle chez nous. La laïcité est un principe pacificateur et un rempart face à la fragmentation qu’il nous faut à tout prix défendre.
Plus généralement, il faut que la nation française, et notamment les jeunes générations, refasse corps. Recréer un tel élan collectif nécessitera des choix forts et durables, au sommet de l’État, pour répondre aux préoccupations de notre population et rebâtir une solidarité, intergénérationnelle notamment, que nous avons laissée s’étioler. Cela passe par une offre de logements abondante (à l’heure où les plus de 60 ans détiennent 60 % du patrimoine financier et non-financier), une imposition du travail plus raisonnable parallèle à une remise à plat du marché de l’emploi (alors que le taux d’emploi précaire des 15-24 ans est passé de 17 % en 1982 à 52 % en 2020) et la restauration de structures capables de recréer du lien social et du sens, autour de principes partagés et de l’intériorisation d’une certaine contrainte. […]
Pour que l’intégration fonctionne, il faut que la France s’aime suffisamment pour donner l’envie d’y adhérer, ce que nous avons oublié à force de repentance et de honte de nous-mêmes. Il ne s’agit pas d’hystériser les problèmes ou de céder à un pessimisme stérile, mais d’être exigeants dans le cap que nous entendons fixer pour que la France ne devienne pas « un pays inhospitalier à lui-même » (Pierre Brochand). Le destin de notre nation n’est ni la partition entre des communautés qui se regardent en chiens de faïence, ni l’affrontement entre des peuples qui se haïssent. Nous devons aujourd’hui avoir le courage de clamer haut et fort que multiethnicisme et multiculturalisme ne sont pas synonymes et que nous sommes viscéralement attachés à l’idée d’un destin partagé.
Louis Gallois : « Quel redressement productif pour la France ? »
Le procès de la désindustrialisation est fait : hémorragie d’emplois souvent qualifiés, déficit structurel de la balance commerciale, perte de souveraineté, fractures territoriales, sentiment de déclassement et de déclin. La désindustrialisation est une des causes majeures du rejet d’« élites » qui n’ont pas su ou pas voulu l’endiguer.
Cela dit, la réindustrialisation ne sera pas une mince affaire. Les positions perdues ont été occupées par d’autres qui n’entendent pas nous laisser les récupérer ; la compétition internationale est féroce et tous les pays mettent en œuvre des programmes de développement industriel, y compris les États-Unis, ce qui est assez nouveau. La Chine a bouleversé le paysage industriel mondial. De nouveaux acteurs veulent jouer leur carte : de l’Inde à l’Indonésie en passant par le Mexique ou le Vietnam.
Il faut expliquer aux Français que ce sera long, qu’il faudra y consacrer beaucoup d’efforts et que, si la réindustrialisation est une priorité, ce sera au détriment d’autres priorités, surtout quand les finances publiques vont mal. Le moment est venu de choisir. Si on ne choisit pas, si on en reste aux demi-mesures, on ne modifiera pas véritablement la donne. Cela veut dire que toutes les grandes décisions publiques devront être jugées non seulement sur leurs mérites propres mais aussi sur leur compatibilité avec une politique ambitieuse, prioritaire, de redressement productif.
De quelle industrie parle-t-on ? Réindustrialiser ne signifie pas reconstruire l’industrie des années 1980 ou 1990. Les relocalisations peuvent bien sûr être utiles et même s’imposer pour des raisons de souveraineté. Mais les causes des délocalisations n’ont pas disparu : coûts de production (coût du travail, de l’énergie, fiscalité) élevés, nécessité de produire sur certains marchés pour pouvoir y vendre. Les consommateurs ne sont pas prêts à accepter les hausses de prix qu’entraînerait le rapatriement massif de certaines productions. C’est l’industrie de demain qu’il faut attirer sur le sol national. […]
Une ancienne ministre de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a eu cette formule heureuse : « L’industrie, c’est 20 % du problème (des émissions de carbone en France) et 100 % des solutions. » Elle avait raison. Toutes les réponses aux questions posées par la transition énergétique et écologique font appel à l’industrie : batteries, hydrogène, éoliennes, photovoltaïque, nucléaire, plastiques biodégradables, agroalimentaire, santé… L’industrie de demain, c’est, pour une large part, cette industrie-là.
