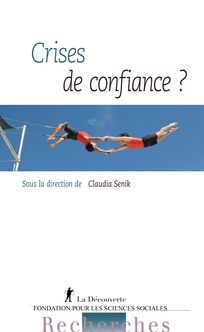
ARTICLE : Le contrôle populaire des élus
EXTRAIT DE L’OUVRAGE COLLECTIF « CRISE DE CONFIANCE ? DU CHAPITRE RÉDIGÉ PAR Charles-Édouard Sénac (2020), pages 56 à 72
UN DE NOS CONTRIBUTEURS NOUS SUGGÈRE DE VOUS DONNER À LIRE L’EXTRAIT DE CET OUVRAGE
« Même le suffrage universel ne définit point la démocratie. […] Un tyran peut être élu au suffrage universel, et n’être pas moins tyran pour cela. Ce qui importe, ce n’est pas l’origine des pouvoirs, c’est le contrôle continu et efficace que les gouvernés exercent sur les gouvernants. »Alain, Propos sur les pouvoirs, Gallimard, coll. « Folio essais », 1985, propos du 12 juillet 1910, p. 213-214.
La République française a-t-elle confiance dans le peuple ? La réponse à cette question est a priori positive : nous vivons dans une république démocratique, comme le proclame l’article 1er de la Constitution de la Ve République et, avant elle, les Constitutions de la IVe et de la IIe République. Le peuple est la source du pouvoir politique suprême, soit qu’il désigne ses représentants, soit qu’il exerce directement sa souveraineté par le moyen du référendum. Pourtant le peuple, en tant qu’entité politique, est presque invisible. La pratique du référendum législatif, relativement fréquente dans les premières années du régime, est tombée en désuétude.
Le peuple, plus exactement le corps électoral, élit ses représentants tous les cinq ans et disparaît. Souverain par intermittence, il est même, pour reprendre les mots de Rousseau, un peuple « esclave » entre deux élections (Du contrat social, 1762, Livre III, chapitre 5).
L’essoufflement des « démocraties représentatives »
La cause de cette léthargie du peuple est bien connue : la France est un régime représentatif, c’est-à-dire un système de gouvernement dans lequel des représentants sont désignés pour exprimer la volonté du peuple. Or l’instauration du gouvernement représentatif n’a, historiquement, rien à voir avec l’idée démocratique, entendue comme le gouvernement des citoyens [Manin, 2012].
Chez ses partisans, la défense du régime représentatif s’est toujours nourrie d’une méfiance vis-à-vis du peuple. Les critiques de Madison et de Sieyès à la fin du xviiie siècle, soulignant notamment l’incompétence de la population et la dangerosité d’un gouvernement populaire, en sont les illustrations les plus emblématiques [Madison, 1787 ; Sieyès, 1789]. Ces opinions, encore largement répandues dans la classe politique et le milieu universitaire, expriment une défiance quasi aristocratique à l’égard de la population. En somme, le régime représentatif est par essence « démophobique » avant d’être devenu, par l’effet de l’extension du droit de suffrage aux élections politiques, démocratique.
Désormais, la défiance a changé de camp ou, du moins, a gagné l’autre rive. Le modèle du régime représentatif, tel que nous le connaissons, est à bout de souffle. Certes, il a probablement toujours existé un doute sur la capacité des représentants à savoir interpréter les besoins des membres du corps social. Mais la désillusion des citoyens à l’égard de la politique semble avoir atteint son paroxysme. Les démocraties représentatives, selon l’oxymore consacré, ne parviennent plus à maintenir le lien de confiance entre les citoyens et les représentants, pourtant censés parler et agir en leur nom. La défiance populaire dans le personnel politique a même atteint des niveaux sans précédent. En juin 2017, pour la première fois depuis 1945, plus d’un électeur français sur deux ne s’est pas rendu aux urnes pour désigner le député de sa circonscription à l’Assemblée nationale (51,3 % d’abstentions au premier tour et 57,4 % d’abstentions au second). En janvier 2019, le baromètre de la confiance politique établi par les chercheurs du Centre de recherches politiques de Sciences Po pour la période 2009-2019 révélait que 74 % des personnes interrogées considèrent le personnel politique comme plutôt corrompu et qu’un tiers seulement des personnes sondées déclarent avoir confiance dans les élus nationaux [Cheurfa et Chanvril, 2019]. À bien des égards, le mouvement des « Gilets jaunes » que la France a connu en 2018 et 2019 a manifesté de manière éclatante l’enracinement d’une défiance populaire envers les responsables publics.
Dans ce contexte, qui ne date certes pas d’aujourd’hui, les pouvoirs publics sont à la recherche de solutions pour donner au régime politique français un second souffle. Le renouveau des instruments de démocratie semi-directe et le développement des outils de la démocratie participative figurent parmi les pistes suivies, avec un succès plus que mitigé.
En effet, les premiers, qui visent à associer les représentants et les citoyens dans la prise de décision politique, se sont révélés incapables de corriger l’emprise des représentants sur la législation. Ainsi, l’instauration en 2008 d’un « référendum d’initiative partagée » illustre la persistance de l’omnipotence représentative et la relégation des citoyens à un rôle secondaire. Cette institution, inscrite à l’article 11 de la Constitution (alinéas 3 à 5), n’est, au fond, ni une initiative totalement partagée ni un authentique référendum. D’abord, l’initiative n’est pas véritablement partagée puisque seuls les parlementaires peuvent déclencher la procédure en rédigeant une proposition de loi cosignée par au moins un cinquième des parlementaires. Ce n’est que dans un second temps, et après un contrôle de constitutionnalité de la proposition par le Conseil constitutionnel, qu’un dixième des personnes inscrites sur les listes électorales peuvent exprimer leur soutien à l’initiative. Ensuite, ce n’est pas un véritable référendum, puisqu’il est prévu que la proposition de loi n’est soumise au vote du corps électoral qu’à la condition que l’Assemblée nationale et le Sénat ne l’aient pas examinée dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que le seuil des 10 % du corps électoral a été atteint. Les représentants de la nation peuvent ainsi facilement s’opposer à la tenue du référendum : soit en adoptant la proposition, en la modifiant le cas échéant, soit en votant contre, soit en se contentant de l’inscrire à l’ordre du jour de leur assemblée puisqu’il suffit que la proposition ait été examinée par les deux chambres pour faire échec à la consultation référendaire.
De son côté, la voie de la démocratie participative, jadis promesse d’un réenchantement démocratique, a de longue date montré ses limites. Les consultations de la population, aussi nombreuses et variées soient-elles, ne lui permettent pas de prendre une part active dans la conduite des affaires publiques. L’organisation, à l’initiative du chef de l’État, d’un « grand débat national » du 15 janvier au 15 mars 2019 en réaction au mouvement des « Gilets jaunes » a ainsi montré que la démocratie participative avait parfois davantage l’allure de faire-valoir des représentants plutôt que celle de laisser-faire des représentés [Courant, 2019].
À côté de ces solutions, il existe une troisième voie, encore peu explorée, qui consiste à institutionnaliser au profit des gouvernés un pouvoir de contrôle sur les gouvernants en instaurant des mécanismes contraignant ces derniers à rendre effectivement des comptes aux premiers. Ces procédures de contrôle populaire des élus, et plus largement de tout responsable public, sont organisées par le droit et, à ce titre, ne doivent pas être confondues avec les capacités d’influence de la foule ou de l’opinion publique qui constituent, chacune à leur manière, un instrument de contrôle social des gouvernants. La foule peut se mobiliser par des manifestations sur la voie publique pour exprimer son mécontentement, obtenir le retrait d’une réforme ou bien pousser un décideur public à démissionner. L’opinion publique, via les médias, les instituts de sondage ou les pétitions en ligne, peut servir ces mêmes fins. Les mécanismes juridiques de contrôle populaire opèrent en parallèle ou en complément des voies informelles de la contestation populaire. Qui plus est, ces procédures sont démocratiques au sens premier du terme : le pouvoir de contrôle est exercé directement par les gouvernés ou les citoyens et non par les médias, des associations ou des autorités publiques (juges, agences de régulation, etc.). Le contrôle populaire se distingue donc parmi les multiples instances de contrôle des institutions représentatives que Pierre Rosanvallon a rassemblées sous le vocable de la « contre-démocratie » [2006].
L’étude des régimes politiques occidentaux révèle l’existence de deux types de pouvoirs de contrôle populaire des élus – on se concentrera sur les fonctions politiques électives. Le premier consiste dans l’instauration de dispositifs de surveillance des gouvernants et de leurs actions. Il s’agit de placer les dirigeants politiques sous l’œil du public, de telle sorte qu’ils modifient leur comportement en fonction de la pression populaire – ces dispositifs sont alors complémentaires des instruments de contrôle social –, ou bien qu’ils puissent être jugés en connaissance de cause par les électeurs le moment venu. Le second type de pouvoir de contrôle populaire regroupe les institutions par lesquelles les gouvernés, plus précisément les citoyens jouissant de leurs droits politiques, peuvent sanctionner directement les décideurs publics ou leurs actions. Ces institutions, au demeurant fort rares dans les démocraties occidentales, sont l’expression la plus tangible d’un authentique pouvoir de contrôle des gouvernants par les gouvernés.
Cela étant, le contrôle populaire des élus est-il soluble dans des régimes représentatifs traditionnellement attachés à la liberté et à l’indépendance des représentants ? Si les pouvoirs publics semblent de plus en plus enclins à demander à la population de leur accorder sa confiance tout au long de leur mandat (et donc ne plus se contenter du seul consentement des électeurs), ils ne paraissent pas pour autant prêts à abandonner la marge de manœuvre considérable dont ils jouissent.
Pourtant la confiance, si elle implique un renoncement à agir directement et une délégation à autrui, n’est pas un abandon ou une inaction [Quéré, 2005, p. 190]. Elle implique une attitude active, une vigilance qui vient sceller le lien de confiance. À cet égard, les mécanismes du contrôle populaire ne sont pas l’institutionnalisation de la suspicion ou bien la négation de la confiance dans les institutions représentatives, mais l’activation d’une vigilance citoyenne. Il s’agit de corriger un système électoral représentatif qui repose sur une confiance aveugle de la population dans les institutions, en vue de rééquilibrer le fonctionnement d’une démocratie représentative, bien plus représentative que démocratique.
L’intensité de la « crise » de la représentation politique et l’incapacité des réformes menées jusqu’à présent à inverser la tendance conduisent à prendre au sérieux les instruments de cette démocratie vigilante. Notre objectif consiste donc à les mettre en lumière en étudiant successivement la surveillance des élus par la population (I), puis leur sanction par les citoyens (II).
La surveillance des élus par la population
L’idée d’un contrôle de la population sur les représentants du peuple est bien plus ancienne qu’il n’y paraît au premier abord. La publicité de la conduite des affaires publiques aux fins de contrôle des gouvernants constitue un projet politico-juridique qui est apparu au cours de la seconde moitié du xviiie siècle, au moment de l’émergence des premiers gouvernements représentatifs [Baume, 2011].
Il se manifesta pour la première fois dans la consécration de la publicité des débats parlementaires. Par la suite, la surveillance populaire des élus a longtemps été cantonnée à l’espace parlementaire ou, plus généralement, délibératif. Ce n’est que récemment qu’elle a connu un nouvel essor avec le développement d’une politique publique visant à garantir la probité et l’intégrité des responsables politiques. La transparence de la vie publique permet désormais à tout un chacun de prendre connaissance de la situation personnelle des gouvernants.
La publicité des débats parlementaires
La publicité de l’espace parlementaire est, historiquement, la première manifestation du contrôle populaire des élus dans les régimes représentatifs. En France, c’est la Révolution de 1789 qui, sur cette matière comme sur tant d’autres, a posé les jalons de la pratique parlementaire à venir. Alors que la question est débattue dès le mois de mai 1789, les députés ont rapidement décidé la publicité des séances des États généraux, contre la décision du roi. Quelques années plus tard, les révolutionnaires ont gravé dans le marbre de la Constitution le principe de la publicité des débats parlementaires : la Constitution de 1791 proclame que « les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés » (chapitre III, sect. II, art. 1er). Ainsi, la publicité parlementaire était consacrée dans ses deux composantes désormais traditionnelles : l’ouverture des séances au public et la publicité du compte rendu des débats qui s’y tiennent par diffusion sur papier. Ensuite, la publicité des débats parlementaires est restée constante dans les régimes politiques libéraux, même si elle a connu des dérogations avec, notamment, les comités secrets tenus pendant la Première Guerre mondiale. En revanche, elle a été fortement restreinte dans les régimes autoritaires, à l’instar du Second Empire. Sous la Ve République, la publicité parlementaire s’est épanouie : elle s’est modernisée avec l’utilisation de la télévision et d’Internet, qui a permis un large accès du public aux séances et aux comptes rendus, et elle s’est étendue progressivement, au-delà des débats en séance, aux travaux des commissions parlementaires.
Si la publicité de l’espace parlementaire est apparue, pour ce qui concerne la France en tout cas, concomitamment à l’implantation d’un régime représentatif fondé sur l’indépendance et la liberté des représentants de la nation, son existence suggère néanmoins l’idée du contrôle de ces représentants par le public. En effet, la publicité parlementaire est pensée comme la condition de la confiance accordée aux gouvernants et la contrepartie du pouvoir politique qui leur est délégué. Ainsi, Benjamin Constant défendait l’idée que la publicité est la garantie la plus efficace contre le gouvernement arbitraire, car elle doit permettre à l’opinion publique et aux journaux de scruter l’action des gouvernants [1814, p. 41]. De même, Jeremy Bentham, pour qui « l’œil du public rend l’homme d’État vertueux », voyait dans le principe de publicité un moyen de contrôle des représentants, par l’instauration d’un « tribunal de l’opinion publique » [1843, vol. 10, p. 145 ; 1843, vol. 9, p. 41 et sq]. Plus récemment, Jürgen Habermas s’est également fait le défenseur de la publicité des débats parlementaires, car elle permet à l’opinion publique de vérifier l’influence qu’elle y exerce [1993, p. 91].
Si la publicité des travaux parlementaires signe les débuts d’un contrôle populaire des élus, ce contrôle reste limité à l’espace et au temps parlementaires. L’exigence de transparence de la vie publique va conduire à élargir sensiblement le champ de la surveillance populaire.
La publicité de la situation personnelle des élus
L’accès du public aux informations personnelles des élus est une thématique contemporaine qui, pour la France, puise néanmoins ses racines dans la Révolution de 1789. En 1793, la Convention adopta une déclaration de principe suivant laquelle « les représentants du peuple sont à chaque instant comptables à la nation de l’état de leur fortune ». Deux années plus tard, le 4 vendémiaire an IV, elle décréta que « chaque représentant du peuple sera tenu, dans le délai d’une décade, et dans celui de deux décades pour ceux qui sont négociants ou marchands, de déposer au comité des décrets la déclaration, écrite et signée par chaque déclarant, de la fortune qu’il avait au commencement de la Révolution et de celle qu’il possède actuellement ; que cette déclaration sera imprimée et envoyée à toutes les communes, pour y être publiée, affichée et soumise à la censure publique ». La postérité de ces décrets révolutionnaires, au demeurant peu appliqués, a été faible, voire nulle. L’idée de permettre à la population de prendre connaissance de la situation patrimoniale des gouvernants est rapidement tombée dans l’oubli. Il faut attendre la Ve République et la réaction législative à l’un de ses scandales politico-financiers les plus tonitruants pour que la publicité de certaines informations personnelles des élus voie véritablement le jour.
L’affaire en question porte le nom d’un ancien ministre délégué du Budget, Jérôme Cahuzac, qui a été poursuivi en justice pour avoir possédé des fonds non déclarés sur un compte en Suisse et qui a été condamné pour blanchiment de fraude fiscale. Cette affaire a donné lieu à l’adoption de deux lois en octobre 2013, qui, entre autres mesures, instituent une Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et assujettissent les responsables publics à des obligations déclaratives portant sur leur situation patrimoniale et leurs intérêts. Certes, la recherche de transparence de la vie publique n’est pas apparue en France après l’« affaire Cahuzac ». En 1988 puis en 1995, le législateur avait, là encore à la suite de scandales politico-financiers, déjà adopté une législation contraignant les plus hauts responsables politiques à remplir des déclarations de patrimoine. Mais, à l’exception de celle du chef de l’État, aucune n’était rendue publique. Les lois de 2013 ont révolutionné le droit applicable en matière de transparence du pouvoir politique [Sénac, 2019]. D’abord, elles rénovent en profondeur le dispositif de la déclaration de situation patrimoniale, dont la finalité première consiste à lutter contre la corruption des responsables publics. Son contenu est détaillé et les dispositifs de contrôle sont renforcés. Pour la première fois, la population peut accéder aux déclarations des plus hauts responsables politiques. Dorénavant, les déclarations de situation patrimoniale des membres du gouvernement et des candidats à l’élection présidentielle peuvent être consultées par toute personne sur le site Internet de la HATVP. En revanche, les déclarations de patrimoine des parlementaires ne sont pas publiées sous la forme de données accessibles à tout internaute, mais tenues à la disposition des seules personnes inscrites sur les listes électorales qui, au terme d’un processus kafkaïen, peuvent les consulter en préfecture mais non les reproduire ou les réutiliser. Ensuite, les lois de 2013 instaurent des déclarations d’intérêts dans le but de prévenir les conflits d’intérêts. Jugées moins sensibles que les déclarations de patrimoine, ces déclarations connaissent un accès bien plus large du public. En plus des membres du gouvernement et des candidats à l’élection présidentielle, de nombreuses fonctions politiques, au niveau national et local, voient la déclaration d’intérêts de leur titulaire accessible par toute personne sur le site Internet de la HATVP.
En permettant l’accès du public aux déclarations des plus hauts dirigeants politiques, les lois de 2013 ont donc étendu très largement la surveillance populaire des élus. Dorénavant, la population est en mesure de veiller à ce qu’ils poursuivent le bien commun et non leur intérêt personnel ou celui de groupes d’intérêt – ces derniers étant également soumis, depuis décembre 2016, à des obligations déclaratives au nom de la transparence de la vie publique. Le pouvoir d’influence de la population reste néanmoins limité, puisque le public ne dispose d’aucun pouvoir de censure. Certes, les citoyens peuvent, au moment des élections, refuser de renouveler le mandat d’un élu dont ils jugeraient le comportement insatisfaisant.
Mais ce pouvoir est en réalité très faible. En effet, il est difficile de prétendre qu’il existe une responsabilité des élus devant les électeurs, pour au moins deux raisons. Premièrement, l’élu peut renoncer à se représenter et donc refuser de soumettre son bilan ou à sa situation à l’appréciation des électeurs, comme l’a illustré le renoncement de François Hollande en décembre 2016 à briguer un second mandat de président de la République. Deuxièmement, l’élu n’est pas seul en lice : le choix des électeurs se fait compte tenu des autres candidats et, plus généralement, en fonction de nombreux facteurs. À cet égard, la surveillance populaire des élus peut apparaître comme une forme imparfaite ou incomplète de contrôle populaire. Seule la sanction des élus par les citoyens parachève l’idée d’un contrôle entier des gouvernants par les gouvernés.
La sanction des élus par les citoyens
La sanction citoyenne des élus est une institution inconnue du droit français, à la différence des mécanismes de surveillance populaire. Le terme « sanction » est pris ici dans son sens moderne, synonyme de peine, et exprime l’idée d’une censure populaire. Celle-ci consiste à donner aux citoyens (et non plus à toute personne car son usage est conditionné à l’appartenance au corps électoral) le pouvoir d’exprimer leur désaccord avec leurs élus. Lorsqu’elle est effectivement adoptée, cette sanction se traduit par des conséquences juridiques qui diffèrent selon l’objet du mécanisme. Le veto populaire permet de rejeter ou d’abroger une mesure votée par les représentants. La révocation populaire conduit à abréger le mandat d’un ou plusieurs élus avant son terme normal.
Le veto populaire
Le veto populaire est une institution qui confie au corps électoral la capacité de s’opposer à une mesure adoptée par les gouvernants en votant contre à l’occasion d’un référendum. Nous entendons ici le veto au sens large du terme, qui correspond à ce que Montesquieu désignait par l’expression de « faculté d’empêcher », c’est-à-dire le « droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre » (L’Esprit des lois, 1748, Livre XI, chapitre 6). Selon cette acception, peu importe que la volonté de s’opposer du corps électoral intègre le processus de confection de la mesure ou bien qu’elle intervienne à l’encontre d’une mesure adoptée. Si les deux modalités d’intervention du corps électoral sont différentes – car dans le premier cas la ratification populaire de la mesure est en principe obligatoire pour que celle-ci soit adoptée alors que dans le second la mesure contestée a pu être adoptée sans l’assentiment populaire –, elles sont toutes deux l’expression de sa capacité à s’opposer, a priori ou a posteriori, à la décision politique des gouvernants. Ce faisant, le veto populaire conduit à soumettre la volonté des représentants à celle du corps des citoyens [Carré de Malberg, 1931, p. 228-229]. Dans les démocraties occidentales, les illustrations les plus connues du veto populaire sont le référendum suisse et le référendum italien d’abrogation d’une loi votée par le Parlement.
En Suisse, les lois fédérales ou certains traités internationaux peuvent être soumis à un vote référendaire si 50 000 citoyens, ce qui représentait en 2020 moins de 1 % du corps électoral, le demandent dans les cent jours à compter de leur publication (art. 141 de la Constitution de 1999). Lorsque la pétition atteint le seuil prévu, l’organisation du référendum suspend la procédure d’entrée en vigueur de l’acte. Puis le corps électoral se prononce pour ou contre l’acte adopté. En outre, dans la mesure où l’organisation d’un référendum est obligatoire pour l’adoption de certaines mesures, par exemple les révisions de la Constitution ou l’adhésion de la Suisse à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales (art. 140 de la Constitution de 1999), le corps électoral dispose également d’un droit de s’opposer à leur entrée en vigueur.
En Italie, 500 000 électeurs, soit environ 1 % du corps électoral italien actuel, peuvent déclencher une procédure de référendum visant à abroger partiellement ou totalement une loi en vigueur, à l’exception notamment des lois fiscales et budgétaires (art. 75 de la Constitution de 1947). Dans un même ordre d’idées, 500 000 électeurs peuvent demander qu’une révision de la Constitution votée par le Parlement soit soumise à référendum avant sa promulgation, sauf dans le cas où la révision a été votée par au moins deux tiers des membres de chaque assemblée (art. 138 de la Constitution de 1947).
Le cas de la France est particulier. Si, dans le passé, le droit constitutionnel français avait esquissé une forme de ratification populaire des lois, avec le rôle dévolu aux assemblées primaires dans la Constitution de 1793, tel n’est plus vraiment le cas sous la Ve République. La procédure de l’article 89 de la Constitution, qui permet la modification du texte constitutionnel, peut certes donner lieu à l’exercice d’une forme de veto populaire. En effet, une révision proposée par des parlementaires doit, après avoir été votée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, nécessairement être approuvée par référendum. Cela étant, aucune révision d’origine parlementaire n’a été votée depuis 1958. En revanche, pour une révision entreprise par l’exécutif, le président de la République dispose d’une alternative après l’approbation du projet de loi constitutionnelle par les deux assemblées : soit convoquer le Parlement en Congrès à Versailles pour une adoption de la révision par les chambres réunies, soit soumettre la révision au vote du corps électoral. Dans ce second cas de figure, réalisé une fois seulement sous la Ve République avec le référendum sur l’adoption du quinquennat présidentiel, les citoyens ont donc la faculté de s’opposer à une réforme votée par les parlementaires. Toutefois, dans la mesure où le président de la République décide librement d’organiser un référendum ou bien, à la place, de convoquer le Congrès, la portée du veto est assez faible. Si les représentants ont le monopole de l’initiative de consulter le corps électoral, le pouvoir d’influence de ce dernier est en pratique fortement limité, à la différence des cas italien et suisse où une fraction du corps électoral peut déclencher la procédure référendaire ou lorsque l’organisation d’un référendum est obligatoire. C’est pourquoi il semble judicieux de réserver le nom de veto populaire aux cas où la consultation du corps électoral n’est pas conditionnée à une sollicitation des gouvernants.
Le veto populaire correspond donc à un type de référendum qui implique que le corps électoral puisse se prononcer sur une mesure adoptée par les gouvernants, qu’elle soit ou non entrée en vigueur, sans que ces derniers puissent s’y opposer. Ce faisant, il est probablement l’institution la plus emblématique de l’affrontement potentiel entre gouvernants et gouvernés : le veto populaire réalise une confrontation directe, sur un sujet précis mais qui peut revêtir en pratique une importance politique majeure, entre la volonté du corps électoral et la volonté des gouvernants. On peut également considérer que le vote négatif du corps électoral est avant tout un désaveu de la majorité politique, davantage qu’un désaveu de l’ensemble des gouvernants. Le veto populaire apparaît ainsi comme l’expression d’un contre-pouvoir citoyen qui permet, dans un contexte d’impuissance des autres forces politiques et notamment de l’opposition parlementaire, de faire entendre une voix discordante. Cette opposition populaire n’est pas antidémocratique, n’en déplaise aux thuriféraires du gouvernement représentatif.
Car si la démocratie représentative suppose la confiance des citoyens dans les institutions politiques, cette confiance n’interdit pas l’expression d’un désaccord, à la différence des régimes autoritaires, d’autant plus lorsqu’il s’agit de laisser s’exprimer la volonté du peuple. L’institutionnalisation de la contestation populaire dans une démocratie vigilante peut également prendre la forme d’une révocation des élus par les citoyens.
La révocation populaire
Certains États sont allés plus loin encore dans le contrôle populaire des gouvernants : ils ont instauré une révocation des élus par les citoyens. Cette procédure permet au corps électoral d’obtenir la destitution d’un élu avant le terme de son mandat. Il s’agit donc d’une compétence juridique qui traduit un parallélisme des formes : ce que les électeurs ont fait, ils peuvent le défaire. Plus encore, à la différence des moyens d’influence de la foule ou de l’opinion publique qui peuvent pousser un élu à la démission, la révocation populaire comporte une dimension éminemment démocratique. Si c’est l’élection qui fait la démocratie, la révocation, qui est son pendant, la pérennise en permettant au corps électoral, et non à une opinion publique dont la consistance est souvent équivoque, de sortir de son sommeil. D’ailleurs, les rapports entre élection et révocation sont plus complexes qu’il n’y paraît. On peut certes les opposer – l’un désigne, l’autre destitue –, mais également les associer. En effet, qu’est-ce que la révocation populaire des élus, si ce n’est le droit du corps électoral à l’organisation d’élections anticipées ?
Si la révocation populaire des élus est beaucoup pratiquée en Amérique du Sud, elle existe également en Amérique du Nord et en Europe. Ainsi, aux États-Unis, trente-huit États fédérés ont adopté des mécanismes de recall. Par exemple, en Californie, une révocation populaire peut viser tout agent public dès lors qu’il a été élu, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un motif particulier pour la révocation (art. 2, sect. 13 à 19, de la Constitution de 1879). Les citoyens à l’origine de la demande de révocation ont cent soixante jours pour réunir le nombre de signatures nécessaire, lequel varie en fonction du poste de la personne visée et du taux de participation à l’élection qui a conduit à la prise de fonction de cette personne. Par exemple, pour la révocation du gouverneur de l’État, c’est-à-dire le chef de l’exécutif californien, il est exigé un nombre de signatures au moins égal à 12 % du nombre de suffrages exprimés lors de la dernière élection. Si la pétition de révocation obtient le nombre de signatures requis, la consultation du corps électoral est organisée dans les semaines qui suivent. Souvent la révocation populaire prend la forme d’une élection anticipée, car des personnes peuvent se présenter contre l’élu contesté. Ainsi, chaque électeur doit répondre à deux questions le jour du scrutin : êtes-vous pour ou contre la révocation du gouverneur ? Si le recall est voté à la majorité des suffrages exprimés, pour quel candidat voulez-vous voter ?
Au Royaume-Uni, le Recall of MPs Act adopté par le Parlement de Westminster en 2015 à la suite du scandale des notes de frais à la Chambre des Communes permet à une fraction du corps électoral de destituer un membre de la Chambre dans des circonstances très particulières. En effet, trois hypothèses sont prévues : premièrement, si le parlementaire a été condamné définitivement à une peine privative de liberté ; deuxièmement, si le parlementaire a été condamné définitivement pour délit de demande frauduleuse de notes de frais ; troisièmement, si le parlementaire a fait l’objet d’une suspension par la Chambre pour une durée d’au moins dix jours de séances ou quatorze jours hors séances. Lorsque l’une des conditions est remplie, la pétition de révocation est ouverte par une autorité publique : si 10 % des électeurs de la circonscription signent la pétition dans un délai de six semaines, l’élu est révoqué. On le voit, la révocation britannique est originale au regard du recall californien (sans compter qu’elle ne porte que sur les parlementaires). D’abord, elle est strictement encadrée puisque les motifs de révocation sont au nombre de trois. Ensuite, son déclenchement est automatique dès lors que l’une des trois conditions est satisfaite, nul besoin d’une pétition signée par des citoyens britanniques.
De plus, la révocation devient effective si une minorité, et non nécessairement la majorité, la soutient. Enfin, elle intervient par le moyen d’une pétition et non d’une votation. Ce n’est que dans un second temps qu’une élection anticipée sera organisée pour pourvoir le poste, si le parlementaire est effectivement révoqué, sachant que ce dernier peut se présenter à cette nouvelle élection.
En Suisse, six cantons ont instauré une procédure de révocation collective des élus qui s’apparente à un droit populaire de dissolution des organes délibérants du canton. Ainsi, dans le canton de Schaffhouse, mille électeurs peuvent proposer le renouvellement intégral de l’autorité exécutive locale, le Conseil d’État composé de cinq membres, et de l’autorité législative locale, le Grand Conseil composé de soixante membres (art. 26 de la Constitution de 2002). Dans l’hypothèse où la majorité des votants se prononce en faveur de la révocation de l’ensemble des élus, de nouvelles élections générales sont organisées.
Si la révocation populaire des élus existe à l’étranger, elle est étrangère à la culture constitutionnelle française. Certes, l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame le droit de la société « de demander compte à tout agent public de son administration » et le projet de Constitution girondine de février 1793 préparé par Condorcet prévoyait une forme de révocation populaire des parlementaires, dans son Titre VIII intitulé « De la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale, et du droit de pétition ». Mais les révolutionnaires n’ont pas fait le choix d’autoriser la révocation populaire des élus. Certes encore, la Ve République a connu, avec le général de Gaulle, une pratique référendaire conduisant à l’engagement de la responsabilité présidentielle devant les citoyens. Toutefois cet usage, laissé à l’entière discrétion de l’intéressé, est en réalité assez éloigné des mécanismes de révocation populaire.
La sanction populaire des élus reste peu développée à ce jour, en particulier dans les démocraties européennes. Il faut dire qu’elle s’inscrit en opposition frontale avec la logique du mandat représentatif qui domine la culture constitutionnelle occidentale. Chère à Sieyès, cette logique veut que l’élu soit totalement indépendant des électeurs au cours de son mandat : il agit librement et ne peut pas être révoqué par eux. Outre le dogme du mandat représentatif, la menace du populisme qui plane sur les régimes occidentaux conduit à envisager avec prudence, sinon méfiance, des procédures qui peuvent conduire à opposer la population aux élites politiques. Enfin, la quête d’efficacité de l’action publique encourage à disqualifier des mécanismes qui pourraient mener à l’immobilisme politique, en cas de multiplication des consultations référendaires et révocatoires.
Mais compte tenu de l’ampleur du malaise démocratique contemporain, est-il encore possible d’ignorer une solution telle que la sanction populaire des élus ? N’est-il pas temps de penser autrement la démocratie représentative et de rénover le lien entre les représentants et les représentés ? Car, en France comme ailleurs, la démocratie représentative paraît être l’horizon indépassable de notre communauté politique. Cependant, le mode de fonctionnement du régime représentatif n’est pas gravé dans le marbre. Il est avant tout le produit d’une idéologie politique qui veut réduire drastiquement l’emprise de l’électorat sur les élus [Kelsen, 1997, p. 340]. Se pose alors la question d’un changement de paradigme du gouvernement représentatif : le moment est-il enfin venu de faire de l’émancipation des citoyens et de la subordination des représentants aux représentés les nouveaux principes directeurs de nos régimes politiques ?
Il serait malvenu de prétendre que l’instauration d’une démocratie vigilante ne présente pas de risque pour le fonctionnement des institutions représentatives. D’abord, en plaçant les élus sous la surveillance du public, on peut craindre l’enracinement d’un climat de suspicion de la population envers ses représentants. Dans ce cas, l’objectif de renouer la confiance du public dans les dirigeants politiques s’éloignerait plus encore. Mais on peut se demander si les termes du problème ne sont pas en réalité mal posés. Ce qui importe avant tout en effet, ce n’est pas la confiance dans tel ou tel personnage politique, mais la confiance dans les institutions politiques. Si le système de surveillance parvient à produire cette confiance, ce qui reste à démontrer, on pourra considérer qu’il a été bénéfique. Ensuite, la sanction populaire des élus peut paraître dangereuse en ce qu’elle organise une concurrence, voire un conflit politique entre gouvernants et gouvernés. Toutefois, elle est aussi un moyen pacifique permettant de canaliser le mécontentement populaire par l’utilisation de voies démocratiques. Elle contraint les représentants à prendre en compte la volonté de la population et limite le pouvoir des forces politiques majoritaires par l’instauration d’un contre-pouvoir citoyen. Enfin, avec le veto populaire, elle conduit les gouvernés à participer directement à l’action législative, de façon négative certes, mais de façon effective. C’est pourquoi, plus que l’expression d’une défiance envers les élites politiques, l’instauration de ces institutions dans la République française serait surtout le témoignage d’une confiance dans le peuple.Mis en ligne sur Cairn.info le 14/11/2020https://doi.org/10.3917/dec.senik.2020.01.0056 PrécédentSuivant

1 réponse »